Depuis quelques jours, on entend des voix sages et autorisées s’élever pour dénoncer les excès de la mondialisation, des ministres plaider pour une relocalisation de la production, des économistes rappeler qu’un financement suffisant des hôpitaux et de la recherche fait partie des fondamentaux d’une économie. Des analystes proposent même que cette crise soit l’occasion de repenser les lois de l’économie et enclencher une transition vers une société plus juste et plus durable. Sous la plume d’un chroniqueur du journal Le Soir du 12 mars, on peut ainsi lire cette tirade : « L’épidémie sonne comme un avertissement qui devrait amener nos sociétés, ceux qui les dirigent et ceux qui les composent, à s’interroger sur leur mode de fonctionnement et sur les risques qu’ils encourent à poursuivre leur « marche folle » ».
On aimerait partager cet élan d’espoir, croire que la crise du covid-19 ouvrira la voie à de grands chantiers démocratiques et une nécessaire transformation des structures économiques à travers le monde. On aimerait croire que l’épidémie forcera le capitalisme à mettre un genou à terre et courber la tête devant le bien commun. On aimerait penser que ce sera plus qu’un épisode passager dans le continuum amnésique et l’agitation permanente de l’information en ligne mondialisée. Seulement voilà : il y a loin de l’invocation d’un avenir meilleur par de belles âmes enthousiastes aux effets concrets de la crise sur le terrain et à la mise en place de rapports de force qui permettraient d’infléchir le cours de notre destinée. Aussi spectaculaire que soit l’impact immédiat du virus – et des mesures adoptées pour le juguler – sur le cours des bourses, ce sont d’abord ses effets immédiats et futurs sur l’économie « réelle » qu’il convient de pronostiquer (voir à ce sujet les prospectives de Paul Jorion).
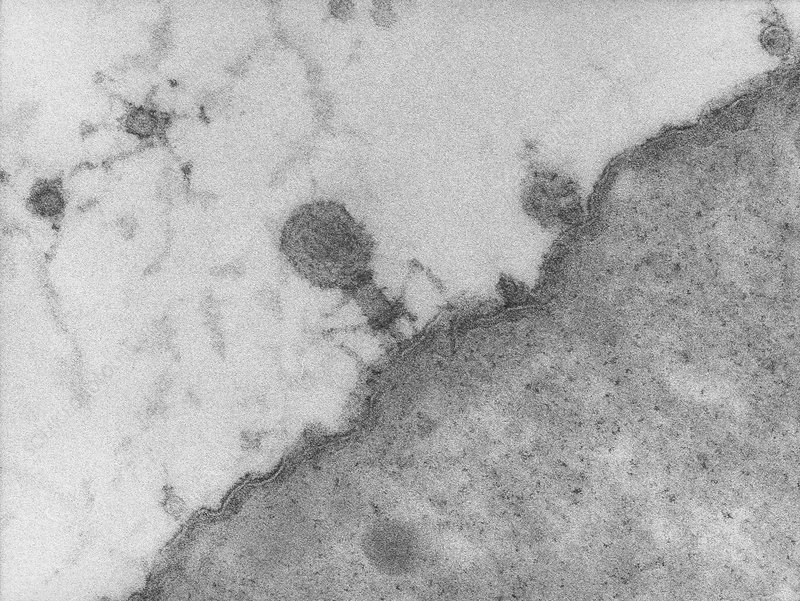
Des gagnants et des perdants
Cela revient à se poser la question binaire : qui gagne et qui perd, aujourd’hui et demain ? Pour y répondre, rien de tel que se plonger dans la presse et les sites spécialisés destinés aux investisseurs. Le 6 mars 2020, le site Yahoo! Finance relève ainsi la bonne santé à court terme des actions des produits pharmaceutiques et alimentaires courants. L’explication est simple : les consommateurs ont le réflexe du stockage, encouragés d’ailleurs par les injonctions officielles des gouvernements. Notons qu’il s’agit à l’évidence de biens produits industriellement à grande échelle et (sur)emballés, comme l’indique l’assaut des consommateurs sur la grande distribution traditionnelle.
Dans un article intitulé « Amazon: A Clear Winner of the Covid-19 Pandemic », le site http://www.gurufocus.com prévoit une appréciation à long terme pour l’action Amazon, phénomène que l’on peut étendre à tous les géants du commerce en ligne ainsi qu’aux plateformes et services qui proposent des outils de communication, de collaboration et de divertissement à domicile et à distance, qui incluent bien évidemment les Netflix, Spotify et autres acteurs du gaming, profitant directement de la désaffection, de la fermeture des cinémas, bars, centres sportifs et l’annulation des concerts, événements et activités variées, y compris folkloriques. Au-delà des effets de krach général et de la volatilité ambiante, tous ceux-là apparaissent comme des bénéficiaires potentiels de la pandémie. Il existe d’ailleurs un indice boursier, le bien nommé « stay at home index », qui rassemble ces « winners » sous une même bannière, et qui permet de mesurer leur croissance.
« Le coronavirus finira par s’évanouir. Pas le QLED 8K de Samsung. » (Forbes)
Ces grands acteurs de l’économie numérique pourraient bénéficier de manière durable de la crise. (a) D’abord parce qu’ils ont peu ou pas de concurrents : selon le magazine L’Usine Nouvelle, cinq acteurs (Amazon, Microsoft, Google, IBM et Alibaba) trustent 63% du marché mondial du cloud d’infrastructure. (b) Ensuite en raison de la santé précaire et du niveau d’endettement des petits acteurs du commerce physique, qui pourraient ne pas se relever de la crise et libérer encore un peu plus le terrain pour ces grands acteurs délocalisé. (c) Enfin et surtout parce que l’une des clés de la croissance rapide des services en ligne est leur capacité à atteindre (« reach ») et « convertir » des consommateurs rétifs à leur usage. Nombre d’investisseurs considèrent qu’une crise telle que celle que nous traversons va pousser, voire forcer des clients rétifs à expérimenter des services auxquels ils resteront fidèles par la suite. C’est la raison pour laquelle l’économiste Bernard Keppenne (CBC, interview rtbf) parle d’un « basculement » des consommateurs vers la nouvelle économie et anticipe une progression des acteurs qui ont misé en amont sur l’économie numérique. De ce point de vue, c’est le site du journal Forbes qui est le plus explicite. « À un certain moment, peut-on y lire, la vie reprendra son cours. Mais ce ne sera plus comme avant. Certaines adaptations temporaires deviendront permanentes. » L’auteur illustre son propos : « Obligés à travailler à distance, des employés vont acquérir de meilleures technologies et augmenter leurs compétences dans leur utilisation. Une fois le danger passé, ils se demanderont pourquoi ils dépensaient tellement de temps et d’argent pour se rendre sur leur lieu de travail. » Ou encore : « Fuyant les cinémas bondés, des spectateurs investiront dans des écrans de télévision 82 pouces. Le coronavirus finira par s’évanouir. Pas le QLED 8K de Samsung ».
Ces quelques indicateurs et exercices de prospective indiquent bien que la crise sanitaire du covid-19 n’est pas forcément une mauvaise chose pour les locomotives de la finance mondiale, qui ont toutes ralliées le projet global de la numérisation intégrale de notre vie professionnelle, sociale, culturelle et économique, au profit de la gigantesque bulle financière du data capitalisme, un projet de « mise en données » et de marchandisation de l’humain jusque dans nos moindres faits et gestes, projet qui s’accompagne d’un nouvel idéal de surveillance totalitaire, sous une forme plus ou moins larvée ou consentie (lire à ce sujet l’ouvrage de B. Harcourt, « La société d’exposition » (1)). Qu’il s’exerce « à la chinoise », de manière brutalement dictatoriale, ou sous une forme plus « libérale » (la surveillance de tous par tous), voire secrète (les collusions de la NSA et des GAFAM), ce projet de surveillance prend lui aussi du galon avec ce virus et les autres menaces qui planent aujourd’hui, car nous sommes toujours prêts à sacrifier nos libertés pour plus de sécurité.
Par conséquent, il est permis de douter que cette crise augure d’une quelconque relocalisation économique et d’une transition vers une mondialisation juste et durable. Tout semble au contraire indiqué une accélération décisive de la mutation vers une société du tout technologique, sous contrôle d’acteurs mondiaux qui délocalisent leur profit et externalisent leurs pertes. Et le mieux (ou le pire) dans tout ça, c’est que ces géants du commerce en ligne ne se priveront pas de présenter cette mutation comme une solution à la crise climatique. Car le discours climatique est désormais au cœur de la rhétorique économique, à défaut d’en être un enjeu majeur ou une préoccupation centrale.
« Nous sommes en guerre ». Mais quelle guerre ?
Non, l’humanité n’est pas entrée en guerre « contre un virus », encore moins « contre le dérèglement climatique ». En tout cas pas à l’heure où nous parlons. Les guerres que livrent les humains sont encore et toujours dirigées contre d’autres humains. Ils s’affrontent pour conserver ou conquérir des territoires et l’accès à des ressources essentielles (ce sont typiquement les guerres entre États). Mais parfois, ils font aussi la guerre à l’encontre de toute logique territoriale, pour empêcher l’émergence ou la résilience de modes de vie et d’organisation qui entravent localement l’exploitation des richesses et leur circulation. Ce sont les vieilles guerres menées par les nomades… mais aussi la guerre néolibérale que nous connaissons actuellement. Une guerre contre tout ce qui nous attache. C’est l’objet du livre de Naomi Klein, « La Stratégie du choc » (2), une stratégie théorisée selon elle par Milton Friedman et expérimentée par la CIA au détriment des sociétés d’Amérique latine (voir aussi notre article Amazon, l’Etat et les guerriers nomades).
Au moment où l’hypothèse du changement climatique s’est muée en une quasi-certitude de catastrophe globale imminente pour les personnes informées de quelque bord qu’elles soient (contrairement à ce qui est répété ici et là, le comportement de Trump, Bolsonaro ou Poutine témoigne d’une parfaite compréhension de la gravité de la situation, en même temps que d’un cynisme à toute épreuve), nous assistons à la naissance d’une guerre qui oppose deux visions du monde aux intérêts divergents. Notre illusion (ou notre désir) que l’humanité unisse ses forces face à un ennemi commun nous empêche seulement de voir que, loin de tout consensus, il existe aujourd’hui deux approches totalement incompatibles de la réponse à apporter au défi climatique.
Plus vite le système s’effondrera, plus grandes seront nos chances de créer de nouvelles formes sociales résilientes.
La première approche suppose une relocalisation radicale de la production et de son organisation, donc aussi de la décision politique. Sa formule est simple : démocratie locale + circuits courts = autonomie politique et autarcie économique. Elle implique aussi de privilégier les « low techs », des technologies simples, non obsolescentes, utilisables et réparables localement (comme le vélo ou le poêle à bois), et de remplacer aussi souvent que possible les machines par les humains (en particulier dans l’agriculture, où le produit du travail peut entretenir la force de travail, forme la plus directe de circuit court). En réalité, ceux que l’on fustige comme les « effondristes » se placent peu ou prou dans cette hypothèse. Même s’ils rechignent à le dire, leur logique voudrait qu’ils souhaitent un effondrement rapide. Non pas en raison d’un reliquat de goût religieux pour l’apocalypse (qui peut exister apr ailleurs), mais parce que plus vite le système s’effondrera, plus grandes seront nos chances de créer de nouvelles formes sociales compatibles avec la résilience des écosystèmes (lire à ce sujet notre article Une obscurité splendide). L’approche « décroissante » ou « effondriste » implique que la plupart d’entre nous devra renoncer à certaines habitudes, à un certain confort dont le coût réel (les « externalités ») est aujourd’hui dissimulé par les disparités réglementaires et sociales du système mondialisé. Mais ce n’est sans doute pas là le principal obstacle. Car le moins qu’on puisse dire, c’est que cette première approche ne plaît guère aux tenants de la seconde, et que ceux-ci ont pour eux la puissance de feu.
L’approche libérale capitaliste se fait une idée toute différente de la réponse à apporter au défi climatique. Pendant que les traders qui font fructifier leur portefeuille d’actions payent des cours particuliers de suédois à leurs enfants en prévision de leur prochain déménagement en zone tempérée (anecdote de Gaël Giraud), les chantres du capitalisme mondialisé tâchent de nous convaincre que la solution est avant tout technologique et passe par un maximum d’automatisation, de connectivité, d’intelligence artificielle, d’algorithmes individualisés (mais aussi de contrôle et de surveillance, notamment pour « optimiser » nos émissions de CO2). Les grands acteurs de la finance mondiale ont vu leurs profits exploser grâce à l’accélération des flux commerciaux et financiers, un phénomène à peine entamé par « l’incident » de 2008 (les indices Dow Jones et Nasdaq ont environ quadruplé depuis lors, selon les sites http://www.boursier.com et http://www.abcbourse.com). Et il serait impensable que le clan néolibéral renonce à mobiliser son immense force de frappe économique et politique pour imposer sa vision d’un avenir climato-compatible (mais surtout capitalo-compatible).
Voilà pourquoi il semble raisonnable de considérer l’axiome suivant : oui, nous sommes en guerre, mais c’est une guerre menée par les forces du néolibéralisme mondialisé contre tous ceux qui ont un lien quelconque avec la terre. Appelons-les tout simplement « les habitants » (voir notre article : « Non merci, on habite ici. »). Les habitants entretiennent des formes de solidarité, de coopération et de symbiose territoriales (le terroir, le savoir-faire local, le quartier, le syndicat, le café, la ferme, le village, le club sportif…). Précision importante : il ne s’agit nullement d’opposer les habitants à ceux que l’on appelle « migrants ». Les migrants expérimentent précisément la perte du territoire à travers l’espoir d’une terre, c’est-à-dire la quête d’un nouvel attachement territorial. Pour le dire en mobilisant les notions de déterritorialisation et de territorialisation proposées par Deleuze et Guattari (3), les migrants vivent de manière tragique la « déterritorialisation » et se mettent à l’écoute des promesses de la terre, cette déesse fertile, grosse d’une infinité de possibles territoriaux. Alors que les habitants sont ceux qui gardent la parole de la Terre, ses inscriptions, ses actualisations territoriales, ceux qui prolongent et entretiennent le dialogue symbiotique avec ses écosystèmes et ses paysages, c’est-à-dire avec les autres (co)habitants, humains et non-humains (d’où l’idée de nature-culture, chère à Philippe Descola et familière aux anthropologues des sociétés amazoniennes).
Deleuze et Guattari ont soutenu que le capitalisme dépend d’une déterritorialisation absolue, un mouvement sans cesse réactivé pour relancer indéfiniment les processus d’exploitation et de profit, destiné à empêcher toute territorialisation, qui enrayerait ou ralentirait nécessairement la dynamique d’extraction et d’accélération des flux et des échanges. C’est un nomadisme sans terre, une migration qui se projette dans l’atopie d’un monde inhabité. Voilà pourquoi le néolibéralisme n’est qu’un autre nom de la guerre menée contre les habitants aussi bien que contre les migrants (qui sont souvent ses victimes directes ou indirectes), même s’il profite de leur opposition apparente. C’est pour cette raison que la stratégie du choc est l’arme néolibérale par excellence (voir plus haut). En termes psychologiques, le choc est ce qui permet de défaire les habitudes, de nous déterritorialiser de notre propre habitus subjectif, pour nous rendre disponibles à une reterritorialisation expresse, en l’occurrence sur le mode d’être du consommateur individualiste, du consommateur connecté, c’est-à-dire du consommateur-zombie. C’est ce que les gourous du marketing numérique désignent d’un terme religieux : la « conversion » (voir plus haut).
Or, les tenants de cette seconde approche ont tout intérêt à ce que la situation continue de se dégrader pendant un certain temps encore, en particulier sur le plan climatique et écosystémique. Plus exactement : jusqu’au point où nous serons collectivement en situation de devoir renoncer à l’hypothèse de la première option, celle d’une démocratie renforcée dans des systèmes naturels-culturels résilients et locaux. Car tout indique que, le moment venu, nous renoncerons avec gratitude aux dernières vapeurs de l’idéal démocratique et aux derniers lambeaux de nature sauvage, au nom de notre propre survie ou sécurité. Cette bascule, qui s’opère déjà aujourd’hui, franchira un seuil crucial lorsque la sauvegarde des milieux naturels et de la biodiversité (dont l’effondrement est au moins aussi spectaculaire que le dérèglement du climat) aura perdu toute crédibilité, ouvrant la voie à la gestion et l’optimisation environnementale, y compris peut-être la création génomique d’une nouvelle techno-biodiversité composée d’organismes génétiquement transformés, tels que des végétaux à croissance rapide stockeurs de carbone et résistants au feu ou encore des pollinisateurs très actifs qui résistent aux traitements chimiques. De la science-fiction ? Peut-être, mais n’est-ce pas déjà à cela que s’affairent nos jeunes bioingénieurs, qui explorent le savoir à travers leur smartphone mais sont incapable de reconnaître le chant d’un oiseau ?
Petit exercice de complotisme raisonné
Comme nous l’avons défendu ailleurs (lire Défense du complotisme), les théories du complot ont au moins ceci pour elles qu’elles offrent un schème d’intelligibilité, une approche narrative et imaginative pour s’approprier collectivement des problèmes qu’on nous présente comme trop complexes pour être laissés aux mains de non experts. Elles sont donc aussi une manière de faire gronder la méfiance et la colère des peuples dans une ère où les institutions démocratiques ont perdu une grande partie de leur pouvoir et de leur crédibilité.
Le complotisme consiste à désigner les bénéficiaires (en général une minorité) d’une situation préjudiciable à la majorité, et souvent à supputer – et exagérer – leur rôle dans l’état de cette situation. Est-ce grave docteur ? Hé bien… S’il est permis aux plus dignes de nos responsables politiques, journalistes et gourous de la communication de nous inonder d’énormités telles que « nous sommes en guerre pour le climat » ou « la technologie nous sauvera » (grâce à notre thermostat connecté, notre voiture électrique, nos énergies vertes, fini les émissions de GES…) – bref, s’il est permis de vanter un « capitalisme vert » – pourquoi nous, petits peuples dispersés, n’aurions-nous pas le droit de poser la question qui fâche, celle de savoir qui sont les bénéficiaires des crises qui nous affectent et qui plombent notre avenir ? Cet exercice, que j’ai tenté brièvement plus haut, semble bien indiquer que les bénéficiaires à terme de l’épisode sanitaire que nous traversons seront bien les grands acteurs de l’économie capitaliste mondialisée, les Gafam et la galaxie des services connectés.
« Évitez au maximum les relations avec vos semblables »
Il ne s’agit évidemment pas de prétendre que le covid-19 a été créé dans les laboratoires de la dictature capitaliste chinoise (laboratoires dont les experts ne cessent de vanter les mérites et la rapidité). Mais bien de rappeler que ce virus, suivi de la vertigineuse chaîne de décisions qu’il a déclenchée, se présente comme l’occasion de propager un autre virus, celui de la société numérique individualisée et libérale, qui nous détache de nos voisins et de notre milieu, de nos habitudes et de nos habitats, en recourant à un bombardement systématique de stimuli qui activent les circuits de la récompense immédiate, par la gratification (socialité du like et de la notation), le renforcement cognitif (saturation de l’attention par des messages de confirmation de nos propres appréhensions) ou encore la stigmatisation morale (orchestration systématique de la dénonciation et de l’indignation à l’égard de tous ceux qui s’écartent des nouvelles normes). Après tout, n’a-t-on pas tous lu et entendu l’injonction : « évitez au maximum les relations avec vos semblables » ? Y a-t-il plus belle formulation de l’alliance objective entre le virus et ce que Klein appelle « Disaster Capitalism » ?
Ce que nous dit le covid-19, nous l’avions déjà entendu lors de la catastrophe de Lubrizol. Il s’agit d’un avertissement, voire d’une menace : « ne comptez pas trop sur vous-mêmes, vos capacités d’autodétermination ou d’autonomisation, car nous sommes en mesure de vous mettre à genoux ». Gageons que les Rouannais, au moment d’acheter leurs légumes à des petits paysans locaux, sur le marché local, ont également entendu cette menace résonner dans leur for intérieur. Nous autres, les gens qui ne vivons pas du nomadisme capitaliste, du big data et de l’accélération des transactions financières, nous sommes assiégés. Le siège, c’est cette technique de guerre adoptée par celui qui a pour lui la force et le temps, mais qui sait que seul le désespoir et l’humiliation de l’adversaire lui assurera la victoire totale. L’issue prévue est une capitulation sans condition. L’abandon de toute souveraineté locale. L’intégration complète dans les réseaux de création de richesse du vainqueur.
La guerre que le capital financier mondialisé et son bras armé, l’industrie numérique, mène sans relâche contre les velléités des peuples à exercer leur souveraineté démocratique et retrouver leur autonomie vitale et leur dynamique territoriale (leur « rugosité », par opposition à l’espace lisse du marché et l’espace strié ou quadrillé du contrôle d’État (3)), est une hypothèse que certains qualifierons de « complotiste », parce qu’elle fait sentir de manière un peu trop forte l’hypothèse d’un conflit d’intérêt entre les populations et les grands acteurs du capitalisme mondialisé. Non pas, bien évidemment, que nous « croyons » que ces acteurs se soient réunis autour d’une table pour mettre au point un virus et planifier les réponses des gouvernements. Mais bien que leur culture commune, qu’ils sont en mesure de partager et d’imposer à tous les niveaux des chaînes de décision économiques et politiques, les pousse probablement à aborder et gérer cette crise dans le sens du basculement évoqué plus haut, vers toujours plus de numérisation, de désincarnation, de déterritorialisation et de désappropriation collective de l’économie. Et cette convergence d’intérêts évidente mérite une intelligibilité qui nous mette en capacité de dire collectivement « non ». Le complot est peut-être l’une de ces armes. La meilleure preuve en est sans doute que l’accusation de complotisme est brandie à chaque fois qu’émerge un discours dont la simplicité est susceptible de pointer du doigt et de mettre en danger l’édifice néolibéral.
D’autres récits de type complotiste pourraient également être mobilisés. Par exemple : les grandes institutions internationales nous préparent à un grand ralentissement économique dans le but d’imposer l’application des Accords de Paris (hypothèse d’un complot « globaliste-humaniste »). Ou encore : la Chine mène une offensive inédite dans la guerre commerciale contre les États-Unis de Trump (hypothèse de la guerre « à l’ancienne », entre États). Voire même : la Chine et des services d’Etat américains agissent de manière coordonnée pour enrayer la dynamique de la réélection de Trump et restaurer la dynamique multilatéraliste des grands accords internationaux (hypothèse qui combine les deux précédente). L’avenir nous dira quel récit est le plus fécond, et comment les populations disparates du monde seront ou non capables de s’en emparer pour faire plier les fossoyeurs de cette planète. Pour ma part, j’observerai attentivement les décisions qui seront prises dans les prochains mois sur la question de la 5G, un enjeu crucial et un indicateur imparable de la direction que prennent nos sociétés, vers une relocalisation et une démocratisation de la production… ou vers la sous-traitance de nos vies et de la terre au capitalisme du big data.
(1) Bernard Harcourt, La société d'exposition, éd. du Seuil.
(2) Naomi Klein, La stratégie du choc, éd. Random House of Canada.
(3) Deleuze et Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, éd. de Minuit.
(4) Deleuze et Guattari, Mille plateaux, éd. de Minuit.