Un appel au peuple de la Terre
La civilisation techno-capitaliste est entrée dans une phase de délitement accéléré et généralisé. On tente ici de réévaluer cet effondrement et les perspectives de résistance pour la symbiosphère à la lumière des données de l’anthropologie classique.
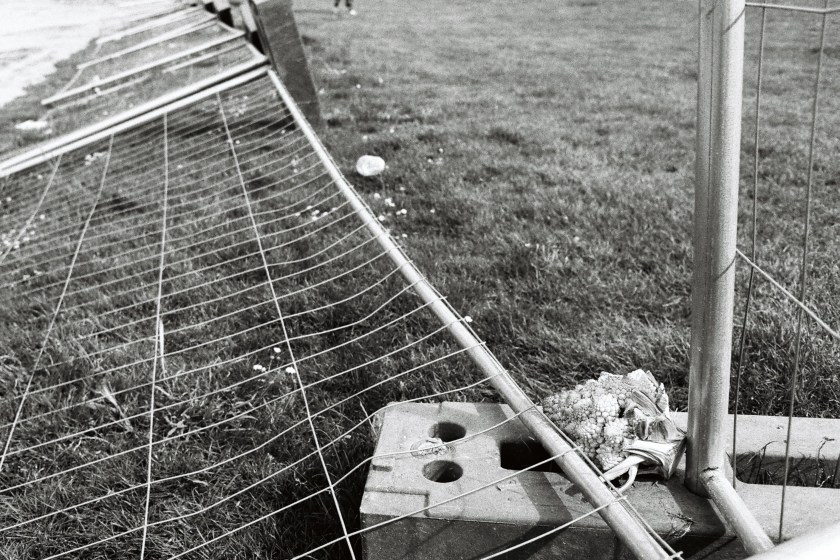
En ce mois de juillet suffocant, alors que la vieille Europe courbe l’échine sous les bombes et voit son économie partir en vrille, on est une nouvelle fois saisi par les vertiges nauséeux de la pensée de l’effondrement. Mais plutôt que de céder au frisson pervers d’une apocalypse annoncée et irrévocable (+3°, +4° ?), il convient de se demander quelle est cette civilisation qui semble imploser sous nos yeux et de quelles ressources nous disposons pour conjurer son sort. Pour ce faire, je repose ici le problème de l’effondrement en l’inscrivant dans les coordonnées tridimensionnelles des grandes prédispositions anthropologiques face aux autres et au monde, abondamment commentées par les ethnologues et synthétisées par Philippe Descola dans son triptyque des « formes de l’attachement » : « don, échange, prédation »[1] (à ce dernier terme, je préfère d’ailleurs celui de « capture », moins lié à un déterminisme biologique et au thème de la chasse : après tout, le prédateur ne choisit pas son éthologie meurtrière et un végétarien peut très bien évoluer dans un système prédateur reposant sur la déforestation et la culture intensive).
La civilisation, entre échange et capture
D’une part, il est évident que le déploiement millénaire triomphal que nous appelons « civilisation » a été synonyme d’une intensification et d’une généralisation des échanges, singulièrement des échanges commerciaux. Ce système d’échange est même en train de connaître un élargissement phénoménal à travers la numérisation, qui permet d’empiler les flux de marchandise, d’argent et d’informations dans un même grand marché exponentiel.
D’autre part, Deleuze et Guattari avaient jadis défini l’État antique comme un « appareil de capture », préfigurant les travaux d’historiens tels que James C Scott, qui voit dans la naissance des premiers États un système rapace et concentrationnaire basé sur la domestication en masse des bêtes et des hommes, affectés à l’exploitation de ressources vitales au service d’une caste de guerriers, dirigeants et idéologues non-productifs[2]. Dans cet horizon, il apparaît alors évident que la marche de la civilisation a également consisté à étendre et peaufiner continuellement ce système de capture et d’exploitation des ressources, notamment en développant des moyens technologiques et biopolitiques visant à minimiser, automatiser ou externaliser le travail productif et permettre à la société de ne se soucier que d’elle-même et sa propre (re)production.
Ainsi, il apparaît d’emblée que ce déploiement inexorable de progrès technique, de contrôle social et de rapacité environnementale (la civilisation), cette mégamachine capitaliste poursuivant le profit jusqu’à sa perte, mobilise massivement deux des trois dispositions anthropologiques fondamentales, au détriment de la troisième – le don – souvent considérée comme la plus ancienne ou archaïque.
La nature, du don au donné
Parallèlement, au cours de ce fastueux déploiement, un oubli a été creusé qui n’a cessé de s’aggraver. Cet oubli – sans doute constitutif de de l’entreprise de capture et de profit – est celui de la Terre entendue comme collectif plurispécifique, relationnel et rituel assurant la coproduction de l’environnement, du climat, des nutriments et de l’énergie. Bref, le substrat symbiotique de toute productivité et de toute habitabilité. Or, c’est justement le brutal retour à l’avant-plan de cette immersion dans le tissu terrestre que nous vivons dans l’ère nouvelle, qui n’est pas tant un anthropocène qu’un Géocène : l’âge où la Terre se rappelle à notre bon souvenir, à la faveur d’un gigantesque et violent retour du refoulé chthonien.
Bien entendu, la civilisation n’a jamais cessé de se gaver des ressources géologiques, écologiques et biologiques terrestres, nous le savons fort bien. Mais la nature a cessé d’être ce monde partagé, immersif et sensitif, pour être projetée à l’extérieur du cercle humain, exclue de la subjectivité, de la culture et de toute exigence religieuse et politique, réduite à un agréable décor extérieur et un stock amorphe de matière première, présumé inépuisable – précisément ce que les économistes appellent « externalités », témoignant de notre incapacité constitutive à penser le vivant. Dans les sociétés du « don », ces externalités aussi procèdent d’un don : elles relèvent de puissances dont les largesses ne peuvent être tenues pour acquises et doivent être accueillies avec prudence et gratitude. Le monde du don est devenu le champ du donné, une « nature » dans laquelle il n’y aurait qu’à puiser.
La civilisation est ainsi un agencement dont la moindre des prouesses n’est pas d’avoir su paraître autoportant, indépendant : le contrat social, comme la loi du marché, se présentent comme des lois qui s’imposent d’elles-mêmes, sans qu’il faille se soucier d’un substrat terrien dans lequel nos sociétés sont pourtant immergées jusqu’aux yeux (nous pensons trop avec les yeux). J’appelle « bulle » cet état de lévitation critique. Et la civilisation est essentiellement production de bulles. Les empires sont des bulles. Les nations sont des bulles. Les marchés sont des bulles. Elles parviennent à nous faire croire que nous sommes les produits de nos lois sociales, et ce que nous consommons, le produit de notre système de production.
L’éthos du don et la confiance-monde
La place du don et de l’échange dans le débat anthropologique est ancienne et bien connue. Descola résume la question dans un texte déjà mentionné, dont l’intérêt est notamment d’y adjoindre la notion de « prédation », mais aussi de démêler les confusions fréquentes entre don et échange, évitant le débat sur la primauté de l’un ou de l’autre. Certes, le don est toujours engagé dans un système multidirectionnel et il arrive qu’il appelle un contre-don. Pour autant, il ne peut être confondu avec l’échange, qui implique que chaque transaction soit conçue dans un système d’équivalence qui suppose un certain degré d’abstraction. C’est pourquoi l’échange conçu « en soi et pour soi » (comme dirait Hegel) aboutit à la monnaie, à la « bulle » des valeurs financières. L’éthos du don, au contraire, semble jouer comme un antidote à la formation des bulles : chaque fruit récolté, chaque animal chassé doit faire l’objet d’un rite de compensation qui acte sa valeur de don et interdit d’y voir un simple « donné ». Cet éthos maintient notre inquiétude fondamentale face à une nature dont les faveurs ne sont jamais acquises définitivement – inquiétude d’âme dans un monde peuplé d’âmes.
Le don semble être un système réservé aux chasseurs-cueilleurs, notamment en Amazonie et dans l’Arctique. Schématiquement, il implique que tout appartient à tout le monde et rien à personne[3]. C’est évidemment simpliste, on pourrait d’ailleurs dire que le gibier « appartient » aux esprits protecteurs, si l’on entend par là que ces espèces sont dotées d’âmes ou soumises à des entités spirituelles qu’il s’agit de séduire ou avec lesquelles il faut négocier ou ruser. Mais justement, là est l’essentiel : nulle part dans la forêt des Amazoniens, il n’existe quelque chose qui ressemble à un réservoir de matière première où l’on pourrait impunément se servir, comme si cela nous revenait de droit, en raison d’un impensable exceptionnalisme humain. Et le présupposé positif de cette conception, c’est que le monde, pour peu qu’on y prenne garde et que l’on montre le respect attendu, est conçu comme globalement et intrinsèquement favorable, généreux, dispendieux (à l’exception notable de certaines entités errantes maléfiques).
Baird-David a forgé l’expression « giving environment » (« environnement donateur ») pour décrire la disposition généreuse de l’Umwelt correspondant à cet éthos qui ignore la propriété et conçoit tous les êtres comme animés et dotés d’une personnalité, au même titre que les humains. Or, indique Descola, le fondement de cet éthos du don dans des sociétés de partage, « n’est rien d’autre que la ‘confiance’ » (p.540). D’où la proximité avec l’échange : chacun agit envers une autre personne, humaine ou non-humaine, « dans l’anticipation qu’elle se comportera à son égard dans la même disposition d’esprit favorable ». Cette confiance évoque celle du philosophe William James, qui y voit le substrat vital nécessaire à toute vie psychique équilibrée – le fait que nous nous tenons les uns les autres dans une grande ronde où chacun danse et tient debout en s’appuyant sur ses voisins, sans que l’un quelconque d’entre nous soit redevable à tel ou tel autre danseur en particulier. Cette vision vaut pour la société, les mondes particuliers des écosystèmes, et jusqu’à cette symbiosphère dont j’ai fait l’horizon de mon travail.
Parenthèse d’anthropologie symbiologique
Cela signifie-t-il que « l’homme est bon par nature » ? Ce serait plutôt que « la nature est bonne en l’humain », et vice-versa. Le vivre-accordé dans la confiance du don implique un mode d’être humain soucieux des autres vivants et attentif aux signes de l’humique – c’est-à-dire à l’épaisseur vivante de la « zone critique », à laquelle nous puisons et participons tous, vivants ou morts. Il ne s’agit donc pas d’adopter un idéal rousseauiste naïf ou un quelconque romantisme de l’autochthonie. « L’homme est bon par nature » est une pensée née dans la bulle, une pensée qui sent le gaz. On la reconnaît immédiatement à ce qu’elle fait de l’homme le sujet unique de son propos, lui donnant même une nature qui n’appartiendrait qu’à lui.
Il en va de même du pendant négatif de l’homme naturellement bon : « l’homme est un loup pour l’homme ». Cette pensée ne peut émaner que lorsque la capture de l’État a déjà coupé le lien au terrien, de façon que l’homme se voie lui-même comme seulement humain et le loup comme seulement sauvage, oubliant leur fond humique commun (ce n’est pas par hasard que cette fiction a servi à fonder le contractualisme moderne). À l’aune de celui-ci, la pensée hobbesienne dissimule pourtant une pensée humique cachée. Cette pensée dit : « l’homme et le chien chassent en meute ». Car l’apprivoisement des loups, leur devenir-chien, et la création d’un langage cynégétique commun entre humains et chiens-loups, sont le non-dit symbiologique de cette pensée indécente qui attribue aux hommes et aux loups une forme d’égoïsme cruel et désespéré qui insulte leur histoire commune comme leurs histoires respectives. Alors, la couche terrienne, épaisse et moelleuse, de la confiance et du don, a cessé d’envelopper et d’inspirer les gestes des humains, de nourrir les sociétés de la sève multispécifique des échanges humiques.
Contre la vision qui s’est répandue dans le sillage du livre à succès de Hariri, je tiens la disposition au don dans un environnement animique comme plus fondamentale anthropologiquement que la prédation et la chasse. Hariri veut voir dans l’extinction de la mégafaune australienne et d’autres phénomènes d’extinction l’expression d’un destin inéluctable et le prélude à la destruction globale de la biosphère, oubliant au passage que les Aborigènes et d’autres peuples autochtones sont les premières victimes de cette destruction[4]. Il oublie aussi et surtout que ces Aborigènes, tout comme les Amérindiens du Nord et du Sud, avaient réussi à stabiliser leurs relations à leur environnement. On reconnaît aujourd’hui que les pratiques d’agroforesterie des Aborigènes (brûlis, aménagement de clairières…) permettaient de prévenir les mégafeux et maintenaient des écosystèmes productifs et riches en biodiversité. On peut en dire autant des Amazoniens et de leurs pratiques de jardinage et de chasse, mais aussi de leur éthos guerrier, corrélat d’une dispersion démographique maintenant la pression anthropique à un niveau compatible avec la fermeture du couvert forestier. Tous ces peuples disposaient de connaissances naturalistes affutées, mais aussi de rites et de pratiques de type chamaniques qui les poussaient à s’interroger et modifier leurs pratiques lorsque l’environnement leur envoyait un signal de perturbation ou de raréfaction de la ressource. Même les Indiens des plaines, dont la survie reposait largement sur la chasse aux bisons, avaient semble-t-il su accorder leur mode de vie nomade à l’abondance de la ressource : ce sont les colons blancs, non les chasseurs indiens, qui ont exterminé les bisons, par la chasse récréative et la clôture des terres pour l’élevage du bétail.
Travestissement prédateur
Le système de capture opère doublement. D’une part, c’est la capture – une fois pour toute – des humains et de leurs pensées dans un collectif-bulle qui a perdu le lien de confiance partageuse avec la terre donatrice et les autres-qu’humains. D’autre part, c’est la capture continuelle des ressources de la « nature » (désormais distincte de « nous ») dans un système technique d’exploitation-extraction brutal et inarrêtable.
Dans ce système, l’échange généralisé (la bulle des marchés) est un vernis civilisé dissimule la prédation généralisée de l’extractivisme. Cette dissimulation est l’essence même du projet de civilisation capitaliste. L’échange et son idéal homéostatique ou progressiste – « l’équilibre de l’offre et de la demande », l’idéal keynésien, la « redistribution », la social-démocratie, la démocratie libérale, etc. – tout cela est une couverture pour une prédation sans vergogne. Dans ce contexte de rapine dissimulée sous une bulle échangiste, l’anthropologie libérale s’impose naturellement, avec sa définition de l’homme comme un être intéressé, égoïste et calculateur. Dans son sillage, c’est la silhouette du consommateur qui s’avance, prédateur humanoïde opportuniste, errant sur le marché, toujours prêt à bondir sur une offre avantageuse, la bonne affaire, tel le jaguar à l’affût, entièrement contenu dans la tension de tout son être vers sa proie, prêt à la dépense, né pour la capture. On réfléchira plus tard[5].
La confiance de l’éthos partageur, qui était comme la « chair du monde » des Aborigènes, un « sol » commun aux humains et aux non-humains – non pas le plan « solide » d’un territoire à conquérir, mais la couche « solidaire » du tenir-ensemble des vivants – tout cela a été arraché à la terre et projeté au cœur de la bulle d’une humanité déshumisée. C’est le fantasme du contrat de l’État moderne, de la confiance des marchés financiers, de l’autonomie du Moi[6]. C’est cela que signifie concrètement la « reterritorialisation » de Deleuze et Guattari. Encore une fois, tout cela ne tient que par le substrat vivant de la zone humique : la terre, la forêt, les fleuves d’eau et d’oxygène qui circulent dans les sols et les airs. C’est-à-dire que la bulle civilisée subsiste présuppose vitalement ce qu’elle nie intellectuellement. Avec le résultat que l’on sait désormais : le retour tragique du terrestre. Les alertes, les secousses et les catastrophes du Géocène.
Prolétariat et tragédie
Reconnaissons que Marx avait flairé la manœuvre. Il avait vu grandir la bulle du Capital. Il avait compris que ses opérations de production et marchandisation entraînaient l’aliénation des travailleurs dans un système de valeurs qui les dépossède de leur travail au seul but de faire croître ce Capital. Alors, pour emprunter à nouveau le langage de Deleuze et Guattari, Marx a cherché à opposer à la reterritorialisation bourgeoise sur le Capital une reterritorialisation prolétarienne révolutionnaire sur le peuple communiste. Seulement, c’est encore une reterritorialisation sans terre, donc incomplète. Et le communisme s’abîmera dans une nouvelle bulle étatique, productiviste et extractiviste.
Aujourd’hui, nous devons reprendre l’ouvrage là où Marx l’a laissé. Élargir le prolétariat marxiste à la vision d’un « peuple de la terre », dans lequel figureront nos bêtes et nos plantes, mais aussi toutes sortes d’autres êtres vivants, souvent hybrides ou invisibles, lichens et champignons mycorhiziens, décomposeurs humiques, parasites et microbes. Y figureront aussi les peuples qui ont résisté au paradigme de la civilisation techno-capitaliste, et avec eux leurs esprits et totems, leurs forêts animées et leurs lieux d’émergence mythique. Ce peuple total, je l’appelle le « peuple tragique », en référence au chœur du théâtre antique, où un peuple élargi s’incarne dans la complainte du collectif féminin qui s’exprime pour tous les oubliés de la cité, tous ces êtres négligés ou ignorés par le drame personnel du héros et de son lignage mâle et royal[7].
Poursuivre la révolution marxienne, c’est donc reprendre le travail humique de la composition d’un peuple, un peuple-terre, tout à la fois humain, végétal et animal. Et cela, c’est d’abord se rappeler ce qu’est la prolétarisation selon Marx. Celle-ci ne se résume pas à une forme inégalitaire de production, dans laquelle les nombreux sont exploités par une poignée de puissants. Il ne s’agit pas d’abord d’égalité ou de justice comptable, de partage des richesses[8]. Car la prolétarisation est avant tout une opération qui sépare les ouvrières et ouvriers de leur puissance. Elle résulte d’une transformation des outils de production en faveur de procès industriels dans lesquelles les savoir-faire, les modes de sentir, les tours de main de l’artisan sont démonétisés. Le but est de transformer la main-d’œuvre en une quantité abstraite, mobilisable massivement et parfaitement interchangeable. Pour l’accomplissement capitaliste, il fallait que le travail acquière la forme liquide de l’argent. Ailleurs, j’ai appelé « labour » cette opération de mobilisation-ameublissement, de pulvérisation-fluidification des solidarités et des attachements singuliers, visant à rendre les choses et les êtres disponibles pour des opérations d’échange et de profit[9]. Le phénomène atteint sans doute son apogée avec le Big Data, cette nouvelle fluidification abstractive qui laboure la psychè sans relâche pour dissoudre nos vies en « bits » de comportements stéréotypés, capitalisables et monnayables : mentions « j’aime », notation de services, pulsions d’achat, unités d’attention (clics)…
Aujourd’hui, la même dépossession que Marx appelait « prolétarisation » s’accomplit dans le « consommariat » et le « connectariat », transformant les citoyens en consommateurs-cliqueurs mus par des visées égoïstes et des pulsions émotionnelles, de manière à les couper de leur puissance de penser et d’agir collectivement (quitte à en offrir un ersatz illusoire sous la forme d’un foisonnement de promesses et labels invoquant la protection de la santé et de la planète). Peut-être assiste-t-on même à la prolétarisation de la biodiversité et des écosystèmes, à travers les notions de « services écosystémiques » ou « d’émissions négatives ».
Appel au peuple de la Terre
Il apparaît aujourd’hui comme une évidence que la bulle civilisationnelle est promise à l’effondrement, pour le pire et le meilleur, et que cet effondrement a déjà commencé. Il semble même que nous devions désirer cette destruction comme une urgence. D’autre part, il est évident que nous ne voulons pas le nouveau marché du capitalisme vert, la comptabilité spéculative des « émissions » et « captations » de carbone, monnaie globale et infâmante pour le monde. Tout comme nous ne voulons pas que l’effondrement prenne la forme (peut-être inévitable transitoirement et déjà opérante localement) de la résurgence autoritaire et belliqueuse des États nationalistes.
Entre le néant de la destruction et la nuit du fascisme, notre seul horizon est de reconstituer le peuple révolutionnaire, un peuple qui devra être étendu bien au-delà des masses productives de l’industrialisation, et qui n’a pas tant les traits d’une internationale anthropocentrique que des alliances locales avec la terre et les vivants. Ce travail de fomentation, de fermentation ou de rumination[10] d’un peuple dense et ramifié, il s’appuie sur la même « foi » jamesienne qui porte le courage du guerrier amazonien à travers la forêt sombre et pluri-habitée : la foi en un monde commun aux humains et aux autres-qu’humains, qui ne tient que par le don et le partage. Il faut en appeler au retour du peuple tragique dans un temps tragique.
[1] Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005, pp.530-547.
[2] On reconnaît ici le fameux thème dumézilien de la tripartition symbolique dans le monde indo-européen (cf. la subdivision des humains en guerriers, prêtres et producteurs (cœur, tête et ventre dans la société de Platon).
[3] C’est toute la perversion du concept de Terra nullius, qui se fonde sur cette absence de propriété pour légitimer l’appropriation par les États européens et les colons.
[4] En insistant de manière obsessionnelle sur le caractère auto-référentiel de l’humain (sa capacité à croire à ses propres fictions), Hariri met en réalité l’accent sur ce que j’appelle la formation de « bulles », prenant pour point de départ et pour acquis la déconnexion de la culture et de la nature, mettant de facto hors-jeu l’éthos du don. C’est pourquoi il néglige les nombreux exemples de sociétés humaines ayant atteint le « succès écologique ».
[5] Et quand on réfléchira, ce sera pour décrire un acteur économique fondamentalement biaisé, qu’il s’agit de manipuler à travers le « management » des populations (cf. Barbara Stiegler dans L’idéologie des biais cognitifs).
[6] Je l’ai plusieurs fois noté, la « société contre l’État » chère à Pierre Clastres est aussi « une société contre l’échange » et la valeur financière, et une « société contre le moi ». La société du don interspécifique est une « société contre la bulle ».
[7] Deux filiations s’affrontent à l’époque tragique en Grèce : d’une part le lignage patrilocal des rois, propriétaires de troupeaux, de femmes et d’esclave, régnant sur des territoires définis ; d’autre part une filiation diffuse et essentiellement féminine, passant par les mères et les nourrices, mais aussi les bêtes et les plantes, qui renvoient de proche en proche à la fertilité primordiale de la grande déesse oubliée : Gaia.
[8] Considérer les choses sous cet angle quantitatif, l’(in)adéquation du nombre et de la richesse, c’est précisément accepter la prolétarisation et le déclassement qualitatif qu’elle produit sur le travail et les travailleurs.
[9] Cf. Le grand labour.
[10] Suivant le titre d’un livre d’Isabelle Stengers, La rumination du sens commun.