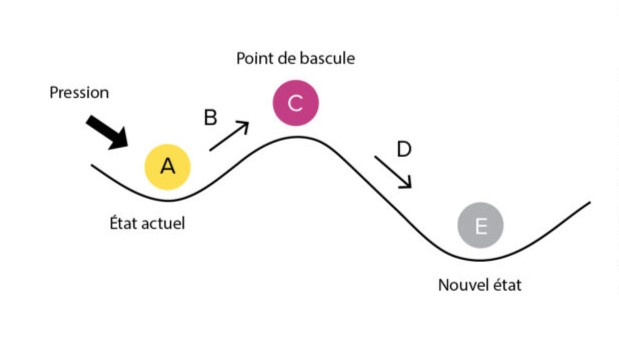Trouver un sens aux évolutions récentes de la situation économique et géopolitique, incarnées avec un panache destructeur par l’administration Trump, paraît tour à tour une tâche inaccessible, et un honneur exagéré rendu aux acteurs qui dominent la scène. Ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas essayer, au moins, de débroussailler l’accès au chemin.
On opte ici pour la formulation de quelques « pensées directrices », qui sont comme « croyances » implicites permettant, sinon d’expliquer, du moins de formuler en termes humainement intelligibles, une réponse à la question : « que nous arrive-t-il ? ».
Plutôt qu’une explication articulée, enchaînant causes et conséquences, il s’agira donc de quelques fragments hypothétiques pour une anthropologie perplexe du capitalisme terminal – ce « capitalisme de fin du monde » qui se déploie sous nos yeux avec fracas, à partir de son épicentre américain, qui en est comme la scène médiatique (bien que les forces agissantes se déploient dans les nations émergentes).